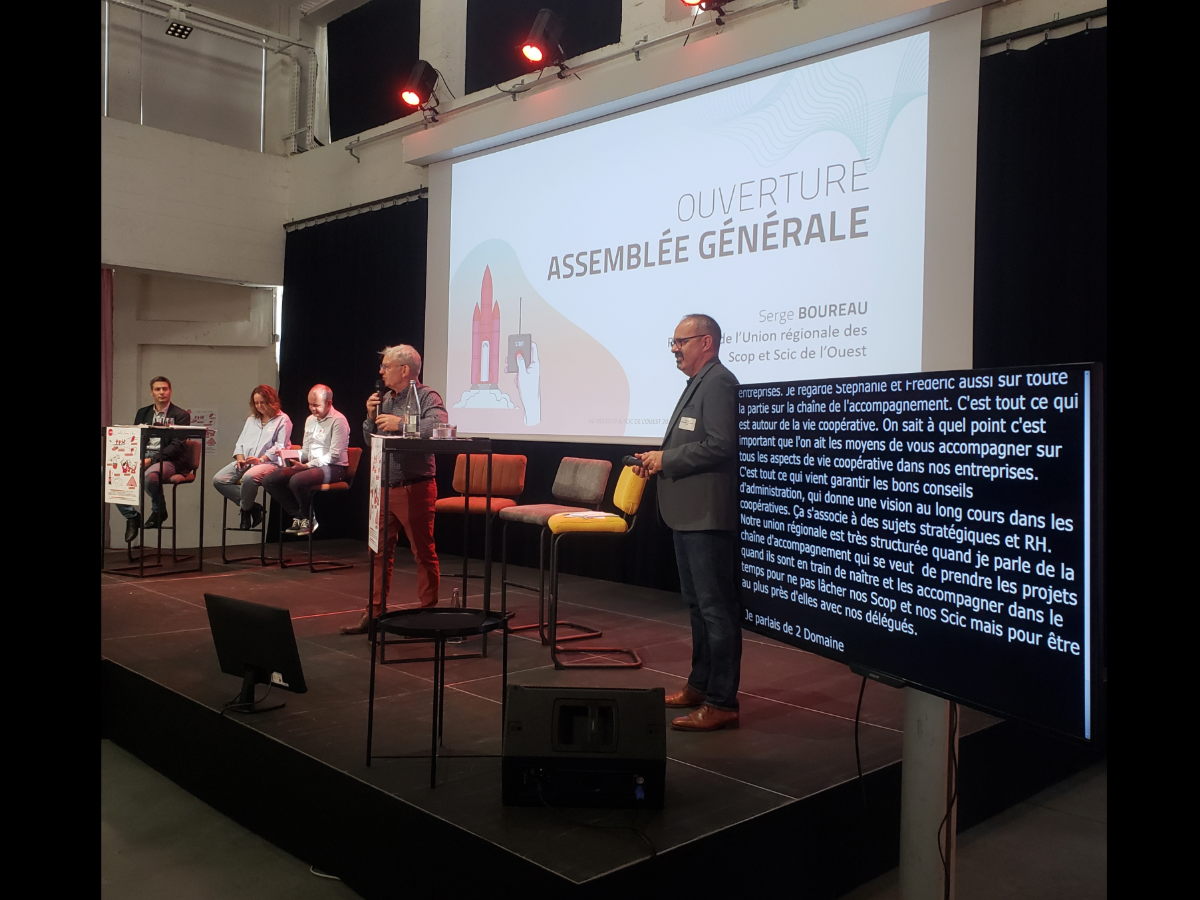Même avec des outils performants, il est impossible de garantir une accessibilité optimale sans une connaissance approfondie des pratiques et usages adaptés. Depuis sa création en 2012, Le Messageur s’est spécialisé dans ces pratiques pour améliorer constamment la qualité de la communication et l’inclusion des personnes malentendantes.
Le « bâton de parole » est au cœur de cette démarche, car il favorise des attitudes inclusives qui permettent aux personnes malentendantes de participer à des échanges sur un pied d’égalité avec les autres participants.
Des pratiques de communication inclusives avec le bâton de parole
En présentiel, l’utilisation du bâton de parole est primordiale pour une communication inclusive avec les personnes malentendantes. Tour à tour, chaque intervenant prend le microphone pour s’exprimer, évitant ainsi les prises de parole simultanées, les interruptions et permettant à la personne malentendante de suivre les échanges en identifiant facilement qui parle. Les micros placés au centre de la table ou équipant tous les participants ne sont pas une solution efficace, car ils empêchent la régulation de la parole et annulent l’effet du bâton de parole. Pour les réunions en visio ou hybrides, le principe est le même ! Un bâton de parole dématérialisé permet à chacun de prendre la parole en allumant son microphone, et la fonction « lever la main » vient réguler les échanges.

Un changement d’habitude dans la manière de s’exprimer…
En l’absence de régulation, il est fréquent que les participants s’expriment simultanément, interrompent leurs collègues ou engagent des conversations privées, ce qui rend la compréhension difficile pour les personnes sourdes ou malentendantes. Ces dernières peuvent manquer des informations importantes et se fatiguer en faisant des efforts pour suivre les échanges.
Ainsi, pour rendre la communication accessible, il est essentiel que le groupe adopte des habitudes de prise de parole régulée, indépendamment des dispositifs d’accessibilité utilisés tels que l’amplification sonore, le sous-titrage en direct, la langue des signes française ou la langue française parlée complétée.
… qui nécessite un accompagnement individuel et collectif
Si demander à ses collègues ou à ses proches de se passer un microphone semble impossible au départ, la pratique a largement fait ses preuves et est rapidement plébiscitée par le groupe. Toutefois, il est essentiel de surmonter les obstacles et les préjugés. C’est pourquoi Le Messageur accompagne les collectifs de travail pour intégrer cette pratique dans toutes les situations de communication qui peuvent poser des difficultés : réunions en présentiel, en distanciel, en hybride et moments informels du quotidien.
Retrouvez aussi cet usage dans les témoignages vidéos de personnes malentendantes et sourdes que nous avons accompagnées.
La valise Diluz et ses bâtons de parole
La qualité de la captation sonore est la clé des échanges accessibles. L’objectif consiste à capter uniquement la voix de la personne qui parle en l’isolant des bruits environnants tels que la soufflerie, la climatisation, les travaux ou la circulation. Cette sonorisation ciblée, effectuée avec la valise Diluz, permet de réguler la prise de parole tout en sélectionnant uniquement le son de la voix de la personne qui s’exprime. Ainsi, le son est directement transmis :
à la personne malentendante dans ses aides auditives,
![]()
aux participants en visioconférence pour les réunions hybrides,
![]()
aux opérateurs à distance (interprètes de l’écrit, interprètes LSF, codeurs LfPC).
La valise Diluz est équipée de 4 microphones à main qui font office de bâtons de parole.
Le microphone - bâton de parole - du Messageur

Le micro que vous apercevez sur cette photo et qui est régulièrement présent dans la communication du Messageur est factice. C’est en quelque sorte notre mascotte, fil rouge de notre communication pour mettre en avant l’importance de la sonorisation des échanges et du rôle de ce « microphone-bâton de parole » dans l’accessibilité des prises de parole. Découvrez-en davantage sur l’histoire de cet objet dans cet article de notre blog.
ILS SONT PASSÉS PAR NOUS
L’équipe du Messageur intervient auprès de nombreuses structures qui lui font confiance.